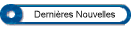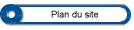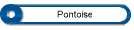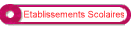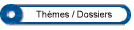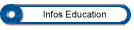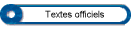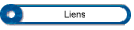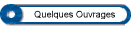Fédération des Conseils de Parents d'Elèves des Ecoles Publiques
L’Autorité
Bruno ROBBES
Congrès départemental de la FCPE 95 – samedi 9 avril 2005
Table ronde
|
Bruno ROBBES Enseignant, prépare une thèse sur l’autorité des enseignants à Paris X -Nanterre (prof : Jacques Pain). C’est une question qui revient en ce moment, un peu plus d’une trentaine d’années après 68. C’est une question complexe, chacun ayant sa propre définition de l’autorité. A la télévision (Pensionnat de Chavagnes, Star Academy), on nous donne à voir une image de l’autorité qui fonctionnerait. A l’Education nationale, F. Fillon introduit les punitions collectives et le travail supplémentaire comme punition. Relations enseignants / parents : Différentes logiques :
Ce qu’est l’autorité : Etymologie : l’autorité n’est pas un phénomène naturel. C’est un phénomène psychologique et social qui est au fondement de toute relation humaine. (Cf. MARCELLI (D.), L’enfant chef de la famille. L’autorité de l’infantile, Paris, Albin Michel, 2003). On ne peut pas se passer de l’autorité, mais on ne peut pas non plus revenir à des temps où l’autorité était confondue avec le pouvoir. On nous dit que le retour à cette autorité fonctionnerait, mais ça ne marche pas. Il ne s’agit pas là en fait d’autorité mais d’autoritaire, d’autoritarisme. Trois sens à l’autorité :
C’est le pouvoir dont sont investies certaines personnes dans le cadre de leur fonction, de leur statut. C’est de l’ordre de l’état de fait. Cette autorité (potestas) est nécessaire mais pas suffisante.
L’autorité de l’auteur (auctor) qui autorise : avoir cette confiance suffisante en soi pour accepter d’être remis en cause par l’autre. Cette estime de soi se construit tout au long de la vie, et dès la petite enfance. Le terme autorité se rattache aussi à la racine augere (faire croître, augmenter l’autre). En ce sens, l’autorité est donc synonyme d’éducation.
Des capacités, des compétences, des savoirs toujours contextualisés, à mettre en œuvre dans l’action quotidienne.
Ce qui va marcher à un moment ne va peut-être pas marcher à un autre moment. L’autorité c’est une relation statutairement asymétrique : il y a un adulte, un enfant avec des statuts différents. Dans cette relation, l’auteur dispose de savoirs qu’il va mettre en action dans un contexte particulier et va exercer une influence sur l’autre sans avoir recours à la contrainte physique (différent du pouvoir). Au départ il y a une asymétrie, puis une symétrie : discussion, négociation pour qu’il y ait de la reconnaissance : processus de légitimation. Les trois logiques :
Dans le discours des enseignants : les parents n’arrivent plus à poser leur autorité, " je n’y arrive plus " disent-ils aux enseignants. C’est l’enfant qui décide : confusion des places générationnelles. C’est l’enfant qui fait la loi aux parents et parfois même aux enseignants.
Il faut donc que la place de chacun soit définie dans le respect mutuel et la réciprocité.
Du côté des parents : ils demandent que les enseignants fassent plus dans l’éducatif, disent que l’enseignant est injuste et qu’il utilise son pouvoir. Ils voient parfois les enseignants comme des concurrents dans l’éducation qu’ils transmettent : par exemple quand un élève accepte d’obéir à l’enseignant mais refuse d’obéir à son parent. Il est essentiel de se reporter aux rôles et aux missions de chacun, même si les missions et les rôles ne suffisent pas. Il y a des savoir-faire, d’où l’importance de la relation, de la communication.
Les enseignants : leur autorité devant les élèves dépend de la conception que se font les parents de l’école, de la fonction enseignante, de l’autorité (par exemple un parent qui contredit un enseignant devant sa classe, ou un enseignant qui dit du mal d’un parent à un élève). Dans certains cas, l’enseignant doit d’abord faire autorité auprès des parents pour pouvoir faire autorité auprès des enfants.
Les enseignants ont une attitude défensive, l’impression d’être remis en cause. Ils demandent du respect.
Il y a la même demande chez les parents.
Certains enseignants donnent des conseils aux parents, et l’inverse. On empiète parfois sur les prérogatives éducatives des parents.
Il faut que ce soit dans la réciprocité, à condition que les droits et les devoirs de chacun soient respectés. Se référer aux textes et aux lois.
La fonction éducative de sécurité et de protection relève des parents si on regarde le code civil. Ce n’est pas pour ça que les enseignants ne doivent pas reprendre à leur compte aussi cette fonction.
On peut développer une logique de coéducation.
Articles publiés par Bruno ROBBES sur la question de l’autorité : ROBBES (B.), " Se défaire de l’autoritaire ", in Cahiers pédagogiques, n° 426, septembre-octobre 2004, p. 20-21. ROBBES (B.), " Du côté de la pédagogie institutionnelle ", in Cahiers pédagogiques, n° 426, septembre-octobre 2004, p. 25-26. ROBBES (B.), " L’autorité après la circulaire " Fillon " : question de sens et de faire ", in site du CRAP Cahiers pédagogiques (www.cahiers-pedagogiques.com), 11 novembre 2004, 5 pages. Ouvrages : PAIN (J.) (sous la direction de), groupe des Marleines, De la pédagogie institutionnelle à la formation des maîtres, Vigneux, Matrice, 1994. HEVELINE (E.), ROBBES (B.), Démarrer une classe en pédagogie institutionnelle, Paris, Hatier, 2000. CASANOVA (R.) (dir.), CELLIER (H.), ROBBES (B.), Situations violentes à l’école : Comprendre et agir, Paris, Hachette Education, 2005 (à paraître en juillet). |
|
|